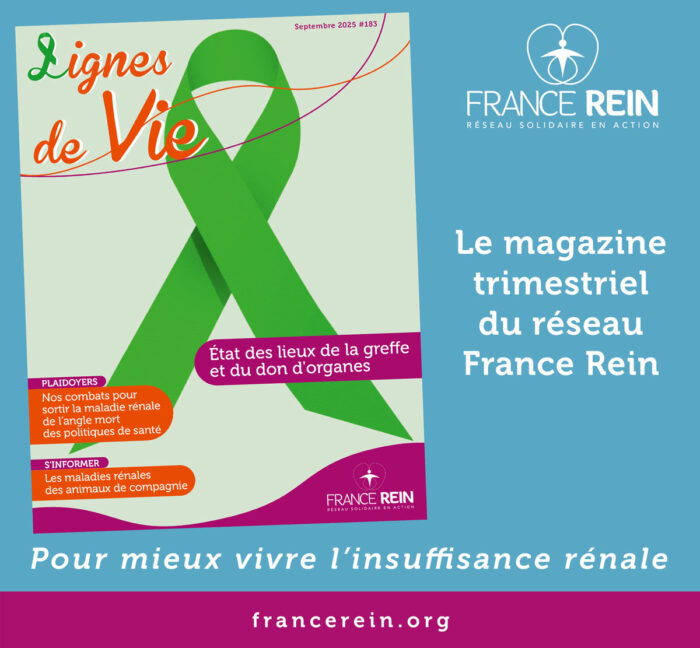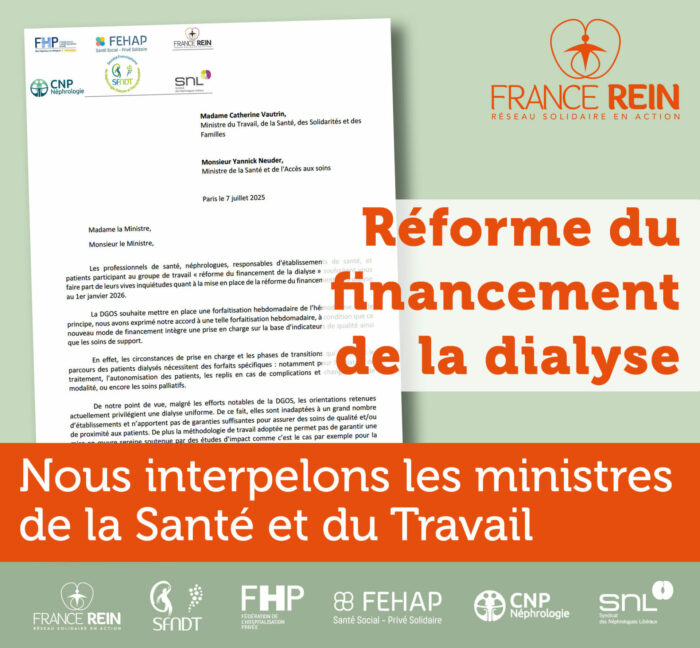Sortons la maladie rénale de l'angle mort des politiques de santé
LES PLAIDOYERS DE FRANCE REIN

Le 13 juin 2025 s’est tenu au palais Bourbon le colloque national de l’Alliance pour la Santé Rénale. Sur place comme en distanciel, la force du moment était palpable : patients, soignants et décideurs unis par une même conviction : la maladie rénale chronique ne peut plus être invisibilisée. Retour sur les temps forts de cette journée particulière.
Un lieu symbolique, le palais Bourbon et l’intervention du ministre de la Santé Yannick Neuder ont donné la note à cette journée sans précédent.
Dès l’ouverture, Jean-Paul Ortiz, président d’honneur de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), a rappelé l’évidence : sans plan national, la MRC continuera de progresser silencieusement, frappant des millions de Français, souvent diagnostiqués trop tard. Puis est intervenue Bénédicte Stengel, épidémiologiste et directrice de recherche à l’INSERM. Elle a dressé un état des lieux : ce que l’on sait aujourd’hui en France sur la maladie rénale chronique, son incidence, son évolution, et les inégalités qui la traversent. Ses données, rigoureuses mais accessibles, ont permis de mesurer l’ampleur du défi. Comprendre l’épidémiologie de la MRC, c’est déjà mieux appréhender les enjeux de sa prise en charge, depuis la prévention jusqu’aux stades les plus avancés.
Dépister tôt, former mieux

La première table ronde animée par Cyrille Dupuis, rédacteur en chef du Quotidien du Médecin, a montré combien la médecine de premier recours est en première ligne. Quant à elle, la médecine généraliste Agnès Oude Engberink a décrit la difficulté à intégrer le dépistage rénal dans des consultations déjà saturées. Pourtant, les outils existent : bandelette urinaire, dosage de créatinine, estimation du débit de filtration glomérulaire. La biologiste Stéphanie Haïm-Boukobza (Cerballiance) et la néphrologue Laurence Vrigneaud (Syndicat des Néphrologues Libéraux) ont insisté : il faut former et soutenir les médecins généralistes pour détecter plus tôt, car chaque année perdue rapproche les patients de la dialyse.
Parcours de soins : briser les silos
La deuxième table ronde, animée par Pascal Maurel
(Université du Changement en Médecine), a mis en évidence ce que beaucoup de patients et de soignants savent déjà : la maladie rénale chronique se vit trop souvent dans un système de soins fragmenté, où les acteurs travaillent chacun de leur côté. Le médecin généraliste Jacques Battistoni, ancien président de MG France, a montré qu’une organisation territoriale plus intégrée pouvait changer la donne. Il a pris l’exemple des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), qui, lorsqu’elles se saisissent de la MRC, favorisent une vraie continuité entre ville, hôpital et structures de proximité. Mais ces initiatives restent encore trop rares et insuffisamment soutenues.

C’est pourtant le témoignage d’Hervé Ancelet, président adjoint de France Rein, qui a donné à la discussion toute sa force humaine. Il a raconté son parcours chaotique : les rendez-vous qui s’enchaînent sans coordination, les examens répétés, les démarches administratives interminables… Son récit a révélé avec justesse comment la désorganisation du système use les corps déjà fragilisés par la maladie, et pèse lourdement sur le moral des patients. Derrière son expérience personnelle, il y a une réalité partagée par de nombreux patients insuffisants rénaux. Pour briser ces silos, il ne suffit pas de bonnes volontés individuelles. Il faut une organisation structurée, des moyens et une reconnaissance institutionnelle.
Vivre avec la maladie, choisir son traitement
Le troisième débat a plongé au cœur du quotidien des personnes au stade 5 de la maladie rénale chronique, lorsque la fonction rénale ne permet plus de vivre sans traitement de suppléance. Anne Hiegel, patiente et présidente de France Rein Pays de la Loire, a livré un témoignage d’une grande intensité. Elle a évoqué sa transplantation rénale, avec pudeur mais fermeté : « On ne veut pas seulement survivre, on veut pouvoir décider. » Derrière cette phrase, toute la revendication des patients : être acteurs de leur parcours, et non spectateurs passifs d’une succession de décisions médicales. Son intervention a rappelé combien la greffe, quand elle réussit, redonne une liberté, mais aussi combien elle reste marquée par l’incertitude, les contraintes thérapeutiques et la peur de la perte du greffon.
On ne veut pas seulement survivre, on veut pouvoir décider.
Anne Hiegel patiente et présidente de France Rein Pays de la Loire

A ses côtés, le Pr Luc Frimat (néphrologue, président du Conseil National Professionnel de Néphrologie) et le Pr Maurice Laville (néphrologue, président de Reinomed) ont défendu la transplantation comme traitement de référence, le plus à même d’offrir une qualité de vie durable. Mais ils ont aussi reconnu la dure réalité : la pénurie d’organes. Trop de patients éligibles restent des années en dialyse, faute de greffon disponible. Les deux experts ont plaidé pour un renforcement du don d’organes, mais aussi pour une meilleure anticipation : inscrire plus tôt les patients sur liste, développer les greffes préemptives, et fluidifier les parcours entre néphrologues et équipes de transplantation.
La psychologue Lucile Montalescot est venue élargir la perspective. Elle a rappelé que le choix entre dialyse, greffe ou traitement conservateur ne pouvait être réduit à une simple équation médicale. Il s’agit d’une décision existentielle, qui engage un projet de vie, des liens familiaux, une identité. Elle a évoqué la nécessité d’un accompagnement psychologique structuré, dès l’annonce de la nécessité d’un traitement de suppléance, pour aider le patient à se projeter dans une vie avec ou sans greffe, avec ou sans dialyse.
L’enjeu d’un grand plan national pour la MRC
La dernière table ronde : "Faire de la Maladie Rénale Chronique l’enjeu d’un grand plan : du dépistage à la suppléance" a été animée par Olivier Mariotte (nile) et réunissait un panel représentatif de toute la chaîne de la prise en charge et de la décision publique. Ainsi, François Vrtovsnik, néphrologue et président de la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT), a rappelé que la communauté scientifique est mobilisée depuis plusieurs années pour alerter sur la gravité de la maladie rénale chronique et sur la nécessité d’une stratégie nationale comparable aux plans cancer ou maladies neurodégénératives. Selon lui, l’infléchissement des nouveaux cas de dialyse observé dans les registres montre que la prévention peut fonctionner mais seulement si elle devient une priorité de santé publique.
Jan Marc Charrel, président de France Rein, s’est exprimé au nom des patients. Avec gravité, il a rappelé que la dialyse et la transplantation ne sont pas des traitements de confort, mais des thérapeutiques vitales qui exigent un accompagnement global : « La qualité de vie, le maintien d’une activité, l’autonomie doivent être intégrés au cœur du futur plan. » Ses mots faisaient écho aux mobilisations que France Rein mène au quotidien.
La qualité de vie, le maintien d’une activité, l’autonomie doivent être intégrés au cœur du futur plan.
Jan Marc Charrel, Président de France Rein

Face à eux, les représentants des institutions ont reconnu la légitimité de cette demande. Marie Daudé, directrice générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère de la Santé, a insisté sur la volonté de mieux intégrer la MRC dans les réflexions à venir, tout en rappelant le cadre budgétaire contraint. Jean-Louis Touraine, pour la Fédération Hospitalière de France, a souligné que les hôpitaux sont prêts à s’engager, à condition d’obtenir des moyens suffisants pour structurer la filière et maintenir une offre de proximité. Olivier Obrecht, responsable du département des patients atteints de pathologies chroniques à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), a présenté la réforme comme une opportunité de simplification et de rationalisation, mais a reconnu qu’il fallait donner une vraie place à la prévention et aux soins de support. Cécile Couchoud, de l’Agence de la biomédecine (ABM), a rappelé les chiffres implacables : l’insuffisance rénale terminale pèse lourd sur le système de santé, mais la prévention en amont, notamment via le dépistage et l’inscription plus précoce sur liste de greffe, peut changer durablement la donne. Enfin, en distanciel, Agnès Firmin-Le Bodo, députée de Seine-Maritime, a apporté une dimension politique à la discussion. Elle a reconnu la nécessité d’un "Grand Plan National pour la MRC", tout en insistant sur l’importance d’un travail collectif, associant Parlement, associations et professionnels.
Cette table ronde a cristallisé l’essentiel du colloque :
l’urgence d’un plan national pour la MRC. Tous les intervenants semblaient s’accorder sur une évidence : la maladie rénale chronique ne peut plus rester dans l’angle mort des politiques publiques.